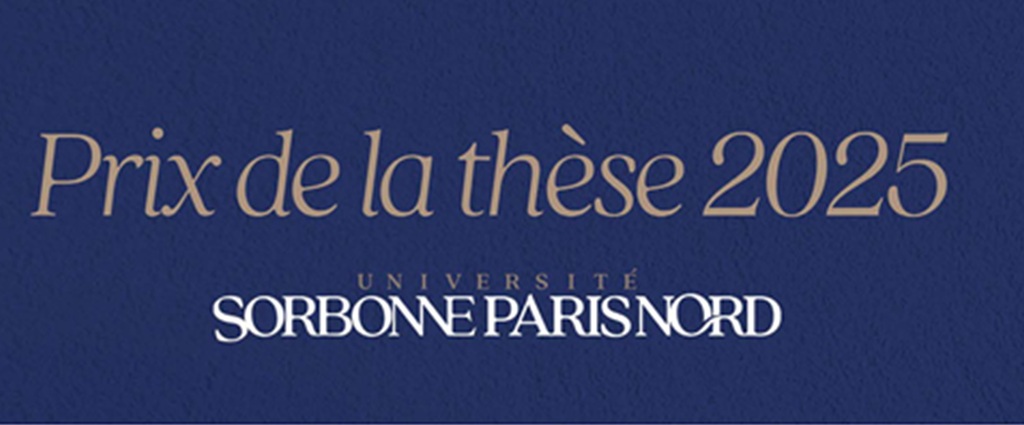Félicitations aux deux docteurs de notre université Elisabeth Iraola et Ivan Garrec, lauréats du prix de thèse de la chancellerie 2025.

Elisabeth Iraola pour sa thèse en santé publique
Sujet : Recours au soin gynécologique et perceptions de l’examen pelvien après des violences conjugales et sexuelles. Du soin gynécologique en suspens aux parcours de soin après des violences
Directeur de thèse : Patrick Chariot
Laboratoire : IRIS
Résumé de la thèse : Contexte : Les violences conjugales et sexuelles représentent un problème de santé publique en raison de leur fréquence et du risque de morbidité auquel elles exposent, en matière de santé psychique, gynéco-obstétricale et sexuelle. Elles constituent aussi une violation des droits humains. Cette recherche a reposé sur le modèle hypothético-déductif d’une association entre les antécédents de violences conjugales et sexuelles et l’absence de recours au soin gynécologique qui pourrait s’expliquer par une aversion pour l’examen gynécologique, l’un des temps constitutifs de la consultation gynécologique. Méthodes : Une étude observationnelle cas témoins impliquant des femmes enceintes consultant pour un suivi de grossesse ou une demande d’interruption volontaire de grossesse, une étude qualitative conduite auprès de femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles recrutées par l’intermédiaire d’une association féministe contre les violences sexuelles et d’un centre d’hébergement d’urgence et une revue systématique ont été menées pour caractériser le recours au soin gynécologique et les perceptions de l’examen gynécologique après des violences conjugales ou sexuelles. Résultats : L’étude observationnelle a montré une association entre les violences conjugales et sexuelles et l’absence de consultation gynécologique dans les deux dernières années chez les femmes poursuivant leur grossesse (respectivement OR 2,13, 95% IC, 1,21?3,73, p=0,008 et OR 1,92, 95% IC, 1,05?3,49, p=0,03), en particulier chez celles ayant subi des violences sexuelles après l’âge de 18 ans (OR 1,95, 95% IC, 1,06?3,56, p=0,03) et celles ayant subi des violences commises par leur ex-partenaire (OR 2,04, 95% IC, 1,15?3,60, p=0,01). L’absence de consultation gynécologique était associée aux violences conjugales ou sexuelles et aux dyspareunies (respectivement p<0,0001 et p<0,0001). En revanche, aucune association entre les violences conjugales ou sexuelles et l’absence de consultation gynécologique n’a été trouvée chez les femmes en demande d’IVG. Les prévalences des violences sexuelles chez les femmes enceintes poursuivant leur grossesse et chez celles en demande d’IVG étaient similaires alors que la prévalence des violences conjugales était supérieure chez les femmes en demande d’IVG (p=0,04). L’étude qualitative a montré que le recours au soin gynécologique après des violences conjugales et sexuelles ne se caractérisait pas exclusivement par une absence ou un moindre recours au soin gynécologique et que l’évitement de l’examen gynécologique ne représentait qu’un des facteurs associés à l’absence de recours au soin. Les parcours de soin après des violences conjugales ou sexuelles se caractérisaient aussi par des consultations gynécologiques annuelles ou régulières et par des consultations gynécologiques fréquentes ou multiples modulées par des facteurs associés aux caractéristiques des violences et à leurs conséquences. La revue systématique a synthétisé les données de 23 études sur le vécu ou les perceptions de l’examen pelvien et le recours au soin gynécologique des femmes présentant des antécédents de violences conjugales et sexuelles. Onze études portaient sur le vécu de l’examen pelvien, dix études ont examiné le recours au soin gynécologique après des violences et deux études portaient sur les deux aspects, impliquant respectivement 7 329, 9 248 et 1 304 femmes. Cette revue a mis en évidence une association entre les violences sexuelles et le vécu négatif de l’examen pelvien ainsi que des résultats plus hétérogènes concernant le recours au soin après des violences conjugales ou sexuelles. Quelle que soit la fréquence du suivi gynécologique habituel, le recours au soin pour des symptômes aigus semblait plus accru après des violences sexuelles. Aucune étude ne s’est intéressée à la relation entre le vécu de l’examen pelvien consécutif à des violences sexuelles et le vécu ou les perceptions des examens ultérieurs dans le cadre du suivi gynécologique habituel ou régulier. Conclusion : Notre recherche souligne l’impact des violences conjugales et sexuelles sur la santé gynécologique, notamment les douleurs et l’état de stress post-traumatique, et leurs implications pour la pratique clinique en gynécologie.

Ivan Garrec pour sa thèse en sociologie
Sujet : Trouble dans les émotions. Enquête sur l’existence sociale du « trouble de la personnalité borderline » en France
Directrices de thèse : Carine Vassy et Isabelle Coutant
Laboratoire : IRIS
Résumé de la thèse : Cette thèse problématise l’existence sociale d’une catégorie de santé mentale genrée et contestée : le «trouble de la personnalité borderline». Pour ce faire, elle éclaire les conditions de sa disponibilité dans l’espace social, les contextes dans lesquels elle circule, ainsi que les pratiques de catégorisation qui participent, concrètement, à la faire exister. L’analyse se fonde principalement sur une enquête ethnographique et sur des entretiens biographiques réalisés dans trois espaces : le segment universitaire de la psychiatrie (urgences psychiatriques), le segment des psychothérapeutes spécialistes du trouble de la personnalité borderline (hôpital de jour spécialisé), ainsi que l’espace des réceptions non-professionnelles de la catégorie. Cette thèse documente ainsi la fonction du trouble de la personnalité borderline ainsi que les intérêts des différent·es acteurs et actrices à son existence. L’existence du trouble de la personnalité borderline repose tout d’abord sur des pratiques professionnelles. Au sein des urgences psychiatriques universitaires, l’usage de la catégorie, qui s’articule avec des stéréotypes de genre, sert à nommer des personnes qui suscitent des tensions dans l’organisation des soins et la définition de la frontière entre normal et pathologique. Du côté des psychothérapeutes spécialistes, le trouble de la personnalité borderline sert de support de professionnalisation au sein du champ de la santé mentale. Au-delà de ces variations, les usages et les significations de cette catégorie reposent sur un fond commun. Le trouble de la personnalité borderline constitue systématiquement une proposition de qualification et de gestion de déviances de genre. Aux urgences psychiatriques, cela se traduit par du rejet; à l’hôpital de jour, la prise en charge spécialisée suscite des mécanismes d’individualisation et de biologisation. Du côté des personnes diagnostiquées ou auto-diagnostiquées, le trouble de la personnalité borderline peut constituer une catégorisation qui donne du sens à des souffrances tout en véhiculant des solutions pratiques, mais elle peut aussi susciter des résistances potentiellement articulées à une perspective politique. Les réceptions de la catégorie se répartissent en trois pôles : un premier pôle est constitué d’appropriations complètes, un second de formes de rejet de la catégorie, tandis que s’insère, entre les deux, un éventail d’appropriations ambivalentes. Tout ceci permet finalement d’éclairer des variations dans les styles de catégorisation de la vie mentale.